Accueil
MP site personnel
Documents
universitaires
Médias
Grand Public
et Jeunesse
Book
The ethics of ordinary technology
Livre
Homo Sapiens
Technologicus
Livre
Développement
Durable
Bibliographies
commentées
Papers in
English 
Interventions
FORUM


BIBLIOGRAPHIE
commentée | 4 x 10 lectures essentielles en
philosophie des sciences
Présentation
- Ne pas savoir quels sont les livres à lire handicape le travail intellectuel presque autant que de ne pas lire du tout. Car lire de mauvais livres, souvent ceux qui sont "poussés" par la publicité ou la servilité, c'est se voler à soi-même le temps pour lire les bons livres. Et se gâter le goût.
- Cette page s'adresse aux étudiants (motivés) et aux autodidactes (ultra-motivés). Un peu fictivement, elle s'organise selon une progression en 4 années de formation.
- Mode d'emploi. On peut puiser : lire dans le désordre, anticiper, rétrograder. On peut remplacer un livre par un autre livre, du même auteur ou sur le même sujet. On doit construire sa propre arborescence bibliographique, car un bon livre est aussi celui qui donne accès à d'autres bons livres.

Les 4 années de formation
année 1 année 2 année 3 année 4 [sélection des livres téléchargeables]année 1
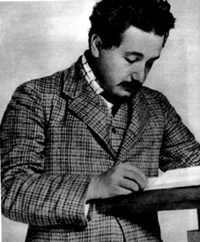
-
HEMPEL Carl G., Éléments d'épistémologie (Philosophy of natural science, Prentice Hall, 1966), trad. B. Saint-Sernin, Paris, A. Colin, 1972
- Objet de ce livre
- La recherche dans les sciences : invention et mise à l'épreuve des hypothèses
- Tester une hypothèse : logique et force de cette opération
- Critères de confirmation et d'acceptabilité
- Les lois et leur rôle dans l'explication scientifique
- Théories et explications scientifiques
- La formation des concepts
- La réduction des théories
-
HAWKING Stephen, Une brève histoire du temps. Du big bang aux trous noirs, Paris, Flammarion (Champs), puis "J'ai Lu"
- Notre vision de l'univers
- L'espace et le temps
- L'univers en expansion
- Le principe d'incertitude
- Particules élémentaires et forces de la nature
- Les trous noirs
- Des trous pas si noirs que cela
- Origine et destin de l'univers
- La flèche du temps
- L'unification de la physique
COLLINS Harry, PINCH Trevor, Tout ce que vous devriez savoir sur la science (The Golem: What You Should Know about Science, Cambridge U.P., 1993, trad. T. Pielat), Paris, Seuil (Points Sciences)
-
KOYRÉ Alexandre, Du monde clos à l'univers infini, trad. de l'anglais, Paris, Gallimard, 1957, repr. Tel
- Le ciel et les cieux
- L'astronomie nouvelle et la nouvelle métaphysique
- La nouvelle astronomie contre la nouvelle métaphysique
- Choses que personne n'a jamais vues et pensées que personne n'a jamais eues
- Etendue indéfinie ou espace infini ?
- Dieu et l'espace. L'esprit et la matière
- L'espace absolu, le temps absolu. Leurs relations à Dieu
- Divinisation de l'espace
- Dieu et le monde
- Espace absolu et temps absolu
- Le Dieu de la Semaine et le Dieu du sabbat Conclusion. L'architecte divin et le "Dieu fainéant"
-
POINCARÉ Henri, La valeur de la science, Paris, Flammarion, 1905, repr. Champs
-
CHALMERS Alan F., Qu'est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend (What is this thing called science ?, University of Queensland Press, 1976, 1982) trad. M. Biezunski, Paris, Livre de Poche, 1987
- L'inductivisme : la science, savoir issu des faits de l'expérience
- Le problème de l'induction
- La dépendance de l'observation par rapport à la théorie
- Introduction au falsificationisme
- Le falsificationisme sophistiqué, les prédictions nouvelles et le progrès de la science
- Les limites du falsificationisme
- Les théories comme structures : 1. Les programmes de recherche
- Les théories comme structures : 2. les paradigmes de Kuhn
- Rationalisme et relativisme
- L'objectivisme
- Une vision objectiviste du changement de théorie en physique
- La théorie anarchiste de la connaissance de Feyerabend
- Réalisme, instrumentalisme et vérité
- Réalisme non figuratif
-
TOULMIN Stephen, L'explication scientifique (Foresight and Understanding, Indiana U.P., 1961), trad. J.-J. Lecercle, Paris, A. Colin, 1973
- Introduction
- Prédire et comprendre
- Conceptions idéales de l'ordre naturel (1)
- Conceptions idéales de l'ordre naturel (2)
- Formes et styles des théories
- L'évolution des idées scientifiques
-
DUHEM Pierre, Sozein ta phainomena. Essai sur la notion de théorie physique : de Platon à Galilée, Paris, Hermann, 1908, repr. Vrin
- La science hellénique
- La philosophie des Arabes et des Juifs
- La Scolastique chrétienne au Moyen Âge
- La Renaissance de Copernic
- Copernic et Rhaeticus
- De la préface d'Osiander à la réforme grégorienne du calendrier
- De la réforme grégorienne du calendrier à la condamnation de Galilée
-
CARNAP Rudolf, Les fondements philosophiques de la physique (1966), trad. J.M. Luccioni, A. Soulez, Paris, A. Colin, 1973
-
MORANGE Michel, Les secrets du vivant. Contre la pensée unique en biologie, Paris, La Découverte, 2005
Mode d'emploi : Un classique simple, légèrement néopositiviste, pour commencer par de bonnes bases. Petit livre clair et lisible, malgré son inébranlable sérieux.
4e de couverture : Comment la connaissance scientifique s'établit-elle, comment se transforme-t-elle ? Appliquée principalement aux sciences de la nature, mais étendue parfois aux sciences sociales auxquelles elle se compare, cette réflexion épistémologique analyse les éléments fondamentaux de la recherche scientifique. Ce grand classique de la philosophie, qui a connu de nombreuses rééditions, constitue une introduction stimulante à l'épistémologie.
Table des matières
Un extrait
Quand il s'efforce de trouver la solution de son problème, l'homme de science peut lâcher la bride à son imagination, et le cours de sa pensée créatrice peut même être influencé par des idées contestables sur le plan scientifique. (...) Pourtant, un principe garantit l'objectivité scientifique : alors que les hypothèses et les théories peuvent être inventées et proposées librement en sciences, elles ne peuvent être admises dans le corps de la connaissance scientifique que si elles subissent avec succès un examen critique, qui comprend notamment la mise à l'épreuve de leurs implications vérifiables par une observation ou une expérimentation rigoureuse.
L'auteur : Né en Allemagne (1905-1997), de formation scientifique, il émigre en 1937 aux Etats-Unis où il occupera plusieurs postes universitaires de premier plan. Il préfère se rattacher à l'"empirisme logique" qu'au néoposivisme de ses maîtres du Cercle de Vienne.
Se procurer ce livre : [sur amazon] ou alors en anglais (mais cher).
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : L'astronomie et la cosmologie contemporaines constituent un domaine rendu accessible par de la vulgarisation de qualité, et utile pour de nombreux problèmes philosophiques. On se transporte avec ce livre, très vite, aux frontières de la science actuelle, en rencontrant au passage plusieurs notions physiques très clairement présentées, pour commencer à se faire de petites fiches...
4e de couverture : Voici le premier livre que Stephen Hawking ait écrit pour le grand public. Il y expose, dans un langage simple et accessible, les plus récentes découvertes des astrophysiciens sur la nature du temps et du monde. Retraçant les grandes théories du cosmos, de Galilée et Newton à Einstein et Poincaré, racontant les ultimes découvertes de l'espace, expliquant la nature des trous noirs, il propose ensuite de relever le plus grand défi de la science moderne : la recherche d'une théorie permettant de concilier la Relativité générale et la mécanique quantique.
Table des matières
Un extrait
[Le principe anthropique fort :] ou bien il existe beaucoup d'univers différents ou bien il existe de nombreuses régions différentes dans un même univers, chacun avec sa propre configuration initiale et, peut-être, avec son propre ensemble de lois scientifiques. Dans la plupart de ces univers, les conditions ne seraient pas favorables au développement d'organismes complexes ; ce n'est que dans quelques univers comme le nôtre que des êtres intelligents auraient pu se développer et poser la question : "Pourquoi l'univers est-il tel que nous le voyons ?" La réponse est simple : s'il avait été différent, nous ne serions pas là !
L'auteur : Physicien anglais (né en 1942), atteint d'une maladie neurologique grave et très invalidante. Son succès scientifique n'a d'égal que le succès de ses livres de vulgarisation.
Se procurer ce livre : [sur site amazon ]
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Une initiation à la sociologie critique des sciences, à partir de cas représentatifs de ce que cette approche peut apporter (on peut lire séparément les chapitres), sans (trop de) "méthodologie" filandreuse.
4e de couverture :
Tout ce que vous devriez savoir sur la science, et que vous avez peut-être même osé demander, sans jamais recevoir de réponses : comment fonctionne-t-elle vraiment ? Que font les chercheurs dans leurs laboratoires ? Peut-on avoir confiance dans leurs découvertes ? Comment s'y retrouver dans leurs controverses ?
La vie sexuelle des lézards, l'histoire de la fusion froide, le transfert chimique de la mémoire, les preuves de la théorie de la relativité, les disputes sur la génération spontanée, etc., autant d'exemples fascinants pour comprendre, à partir des études les plus novatrices de la sociologie des sciences, la nature de la science contemporaine et ses véritables enjeux.
Table des matières
Préfaces
Introduction : Le golem
1. Je mange, donc j'apprends : le transfert chimique de la mémoire
Introduction
Les vers
Les mammifères
Le dénouement
2. Les preuves décisives de la théorie de la relativité
Introduction
La Terre vogue-t-elle sur une mer éthérique ?
Les étoiles se déplacent-elles dans le ciel ?
Conclusion
Appendice
3. Le Soleil dans une éprouvette : l'histoire de la fusion froide
Fusion : une approche de "coin de table"
L'entrée en lice de Jones
La controverse
La fusion froide : une impossibilité théorique ?
Conclusion
4. Les germes de la discorde : Louis Pasteur et les origines de la vie
La génération spontanée
La nature des expériences
Les solutions pratiques aux problèmes posés
La controverse Pasteur-Pouchet
Les expériences "sous mercure"
Les ballons placés en altitude
Péchés de commission
Vue rétrospective et prospective sur la controverse Pasteur-Pouchet
Épilogue
5. Une nouvelle fenêtre ouverte sur l'univers ? L'impossible détection du rayonnement gravitationnel
La détection des ondes gravitationnelles
La régression de l'expérimentateur
Le rayonnement gravitationnel : 1975
Conclusion
6. La vie sexuelle du lézard à queue en fouet
Introduction
"Femelles lézards : des lesbiennes et des sauteuses"
Morsures amoureuses et appels de pattes
Un match nul honorable
7. Cap sur le centre du Soleil : l'étrange histoire des neutrinos solaires manquants
Une collaboration exemplaire et la préparation de l'expérience
La science en train de se défaire
Post-scriptum de 1992
Conclusion : mettre le golem au travail
Regard sur le passé, coup d'oeil sur l'avenir
L'errreur humaine
Comment le public comprend-il la science ?
La science et le citoyen
La science et le droit
Enquêtes publiques
Expériences ou démonstrations dans le domaine public
La science à la télévision
Les enquêtes sur les accidents
L'éducation scientifique
Bibliographie
Index
Les auteurs : Harry Collins est Professeur de sociologie à l'université de Cardiff (Grande-Bretagne) et Trevor Pinch à l'université COrnell (États-Unis).
Se procurer ce livre : [sur site amazon], ou en anglais [on amazon site].
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Ce que nous appelons "science" a une histoire, est issu d'une révolution dans la vision du monde. Ce livre d'histoire philosophique des sciences retrace cette histoire, autour des idées sur l'espace, le temps, le cosmos.
4e de couverture : La pensée philosophique et scientifique a accompagné une révolution profonde aux XVIe et XVIIe siècles. De Copernic à Galilée, de Descartes à Newton et à Leibniz, Alexandre Koyré retrace les étapes de cette révolutio spirituelle.
Table des matières
Index
L'auteur : Philosophe et historien des sciences d'origine russe (1882-1964), études en Allemagne et en France, où il s'installe.
Se procurer ce livre : Disponible
en poche : [site
amazon].
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Un livre de mathématicien, physicien et philosophe, qui voit de l'intérieur les questions de constitution d'une science — au début du XXe siècle. Ses positions sont parfois ambiguës, mais elles constituent une introduction claire aux problèmes de base sur la nature de la science.
4e de couverture : Pour Henri Poincaré, le but de la science n'est pas l'action. Si la science est utile, c'est parce qu'elle est vraie, mais elle n'est pas vraie parce qu'elle serait utile. Elle n'a pas d'autre fin qu'elle-même, la connaissance désintéressée, la science pour la science : "Ce que nous appelons la réalité objective, c'est, en dernière analyse, ce qui est commun à plusieurs êtres pensants, et pourrait être commun à tous ; cette partie commune, nous le verrons, ce ne peut être que l'harmonie exprimée par les lois mathématiques."
Table des matières
Introduction
Première partie : Les sciences mathématiques
o Chapitre premier : L’intuition et la logique en
mathématiques
o Chapitre II : La mesure du temps
o Chapitre III : La notion d’espace
o Chapitre IV. L’espace et ses trois dimension
Deuxième partie : Les sciences physiques
o Chapitre V : L’analyse et la physique
o Chapitre VI : L’astronomie
o Chapitre VII : L’histoire de la physique
mathématique
o Chapitre VIII : La crise actuelle de la physique
mathématique
o Chapitre IX : L’avenir de la physique
mathématique
Troisième partie : La valeur objective de la science
o Chapitre X : La science est-elle artificielle ?
o Chapitre XI : La science et la réalité
L'auteur : Savant et philosophe français (1854-1912), auteur de nombreux travaux, dont certains proches de ceux d'Einstein, et de livres devenus classiques sur la science.
Se procurer ce livre : en ligne et gratuitement [sur Wikisource], en papier et pas gratuitement [sur site amazon].
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Un résumé très abordable des philosophies de la science les plus classiques. Du prêt à l'emploi pour les dissertations de 1e ou 2e année... mais pas pour toute sa carrière.
4e de couverture : Premier bilan qui prenne en compte les développements les plus récents de la philosophie des sciences, Qu'est-ce que la science ? propose un panorama stimulant des grands travaux issus de l'école du positivisme logique qui, depuis quelques décennies, connaît un formidable essor dans le monde anglo-saxon.
Table des matières
Un extrait
L'époque moderne tient la science en haute estime. La croyance que la science et ses méthodes ont quelque chose de particulier semble très largement partagée. Le fait de qualifier un énoncé ou une façon de raisonner du terme "scientifique" lui confère une sorte de mérite ou signale qu'on lui accorde une confiance particulière. Mais, si la science a quelque chose de particulier, qu'est-ce donc ? Ce livre est une tentative d'élucider cette question et d'aborder des problèmes de ce type.
L'auteur : Physicien et philosophe des sciences, né en Angleterre et installé en Australie.
Se procurer ce livre : en livre de
poche [site
amazon].
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Des analyses qui sortent un peu des sentiers battus et scolaires, tout en restant très claires et utilisables. Pour éviter de penser qu'on a tout compris dès qu'on a lu un peu de Popper et de Kuhn.
4e de couverture : Qu'est-ce que la science ? L'auteur estime qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il est vain, selon lui, de s'acharner à formuler une définition universellement valable de la "méthode scientifique". S'il y a une "rationalité" de la recherche, elle revêt des formes différentes selon les lieux, les époques et les disciplines. Les épistémologues ont souvent tendance à reconstruire la science de façon trop normative ; les historiens, eux, sont plus conscients de la complexité de la vie des sciences, mais négligent d'en analyser certains aspects significatifs. Evitant toute érudition, l'auteur propose une analyse réaliste qui permet de répondre à cette question fondamentale : comment évalue-ton le mérite d'une théorie scientifique ?
Table des matières
L'auteur : Philosophe britannique, né en 1922, influencé par Wittgenstein.
Se procurer ce livre : D'occasion, ou en bibliothèque, car ce livre hautement utile est épuisé. Faire un effort pour y accéder, au lieu d'acheter les fadaises en promo.
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Histoire des sciences, de l'Antiquité au XVIIe siècle, sur la structure de l'univers, pour défendre la position de Duhem en philosophie des sciences : le phénoménisme — la science doit rendre compte des phénomènes mais elle n'est pas en mesure de dire ce qu'est réellement le réel.
Table des matières
Un extrait
Les hypothèses astronomiques sont de simples artifices destinés à sauver les phénomènes ; pourvu qu'elles atteignent à ce but, on ne leur demande ni d'être vraies, ni même d'être vraisemblables.
L'auteur : Physicien, historien et philosophe des sciences français (1861-1916). Il veut que la "théorie physique" ne soit qu'un système de représentation correspondant au réel, mais pas la vérité du réel lui-même, car pour lui la vérité ne peut venir que de la métaphysique, de la métaphysique vraie, qui est celle du catholicisme. D'où d'étranges prises de position, mais d'une grande fécondité théorique (Quine reprendra en particulier son "holisme").
Se procurer ce livre : disponible
en poche chez Vrin [site
amazon]
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : L'enseignement de
celui qui fut le
maître de la philosophie des sciences anglophone. Il
définit les problèmes de base et y imprime la
marque d'un
positivisme teinté d'empirisme. Il faut s'approprier cette
base
avant de songer à aller plus loin.
Après avoir étudié ce livre, en
prenant le temps
(et des notes abondantes), on peut commencer à se sentir un
peu
compétent en philosophie des sciences.
4e de couverture (de l'édition en anglais): Rudolf Carnap, l'un des philosophes les plus originaux du XXe siècle, a donné une série de cours sur la science à l'université de Californie en 1958. Ce volume est un développement de cet enseignement, qui portait sur les fondements philosophiques de la physique. Edité par Martin Gardner à partir des transcriptions de cours et de discussions de Carnap, ce livre demeure l'une des introductions les plus claires et les plus sûres à la philosophie des sciences.
Table des matières
Partie I. Lois,
explication et probabilité
1. A quoi servent les lois : explication et prédiction
2. Induction et probabilité statistique
3. Induction et probabilité logique
4. La méthode expérimentale
Partie II. La mesure et le langage
quantitatif
5. Trois sortes de concepts scientifiques
6. La mesure des concepts quantitatifs
7. Les grandeurs extensives
8. Le temps
9. La longueur
10. Les grandeurs dérivées et le langage
quantitatif
11. Les avantages de la méthode quantitative
12. La conception magique du langage
Partie III. La structure de l'espace
13. Le postulat d'Euclide sur les parallèles
14. Les géométries non euclidiennes
15. Poincaré contre Einstein
16. L'espace dans la théorie de la relativité
17. Les avantages d'une théorie non euclidienne des espaces
physiques
18. Kant et le jugement synthétique a priori
Partie IV. Causalité et
déterminisme
19. La causalité
20. La causalité implique-t-elle la
nécessité ?
21. La logique des modalités causales
22. Déterminisme et libre-arbitre
Partie V. Lois théoriques et
concepts théoriques
23. Théories et non-observables
24. Les règles de correspondance
25. Comment de nouvelles lois empiriques sont
dérivées des lois théoriques
26. L'énoncé de Ramsey
27. Les énoncés analytiques dans un langage
d'observation
28. Les énoncés analytiques dans un langage
théorique
Partie VI. Au-delà du
déterminisme
29. Les lois statistiques
30. L'indéterminisme en physique quantique
L'auteur : Né Allemand en 1891, mort Américain en 1970. En émigrant, il emporte avec lui le meilleur de la philosophie des sciences d'Europe centrale, qui deviendra le meilleur de la philosophie des sciences anglophone. Son positivisme n'est jamais dogmatique, il se remet sans cesse en question, change de forme, porté par une droiture intellectuelle admirable.
Se procurer ce livre : A lire en
bibliothèque, en
français, la traduction étant lamentablement
épuisée. Mais disponible en anglais (sous le
titre : An Introduction to the Philosophy of Science)
pour une dizaine d'euros... : [site
amazon].
C'est le moment de se demander s'il ne va pas falloir se mettre
à lire en anglais, et la réponse est oui, il faut
s'y
mettre le plus vite possible.
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : La biologie contemporaine renouvelle profondément la théorie, la pratique, et le contexte, de ce qu'est une science aujourd'hui. Pour en donner la mesure il faut conjuguer des qualités de compétence et de clarté qui sont déjà rares à l'état séparé. D'où le potentiel pédagogique de ce livre pour le philosophe des sciences. Être particulièrement attentif en le lisant à tout ce qui peut être étendu, au-delà de la biologie, de la réflexion critique sur l'explication dans ce livre.
Table des matières
Avant-Propos
Des espoirs toujours déçus
De la nécessité absolue d’articuler des principes d’intelligibilité différents
Le plan suivi
I. Ce qu’expliquer veut dire
1. Ma découverte de la diversité des explications en biologie
L’explication des propriétés de régulation de certains enzymes
Expliquer une fonction jusqu’alors inconnue
Les maladies du repliement
2. Brève introduction philosophique au concept d’explication
Ce qu’expliquer veut dire
Une pluralité des modes d’explication
Diversité ne signifie pas chaos
3. Des principes d’intelligibilité en évolution
Du iatromécanisme à la naissance de la biologie
La révolution moléculaire
La tentation hégémonique de la biologie moléculaire
II. La coexistence de trois schèmes explicatifs différents dans les sciences du vivant
4. Des explications de type mécaniste
La genèse du mécanisme moléculaire
Le canal potassium
La mécanique moléculaire de l’olfaction
5. Des explications de type darwinien
Les différentes formes de l’explication darwinienne
Usage et abus des métaphores
La nécessité d’articuler avec d’autres schèmes explicatifs
6. Des explications de type physique non causal
Des explications déjà anciennes
De nouveaux travaux, apportant de nouvelles explications
Révéler les limites et les contraintes dans les systèmes biologiques
III. Expliquer aujourd’hui dans les sciences du vivant : quelques exemples
7. Expliquer les phénomènes migratoires
8. Expliquer les épidémies : le cas particulier de la grippe espagnole de 1918
Il n’y a jamais d’explication unique à l’origine d’une épidémie
La grippe espagnole de 1918
9. Expliquer le cancer, au-delà des oncogènes
La théorie des oncogènes
Les faiblesses du modèle
La nécessité d’articuler des explications de type différent
10. Expliquer le vieillissement et la maladie d’Alzheimer
Les explications moléculaires du vieillissement
Quel lien y a-t-il entre le métabolisme des sucres et le vieillissement ?
Les explications évolutionnistes du vieillissement
L’objectif est ici encore d’articuler des schèmes explicatifs différents
11. Expliquer l’apparition de l’être humain
La recherche des gènes de l’hominisation
Le gène FoxP2 et les limites d’une approche uniquement génétique
12. Expliquer à l’âge de la post-génomique
Discussion et conclusion : pour un approche pluridisciplinaire
Une nouvelle interprétation de quelques débats
Trois schèmes explicatifs principaux
Articuler ces différents principes explicatifs
Les difficultés rencontrées
Il y a un enjeu éthique à surmonter ces difficultés
Quelques suggestions pour optimiser les articulations
Un extrait
« Les historiens et les philosophes des sciences, qui ont eu beaucoup de mal ces dernières années à renouveler l’étude des sciences et à chasser les formes dégradées d’histoire et de philosophie produites par les scientifiques, ont trop souvent aujourd’hui pour seule ambition de donner à leurs disciplines le même statut et la même dignité qu’aux sciences elles-mêmes, même si, pour atteindre cet objectif, ils doivent s’isoler par un discours de plus en plus abstrait et coupé de la réalité du travail scientifique, et en appauvrir ainsi le contenu. »
L'auteur : Biologiste, mais aussi dans les faits philosophe des sciences très pertinent, professeur à l'université Paris-VI et à l'École normale supérieure.
Se procurer ce livre : [sur site amazon]
[< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années]
année 2
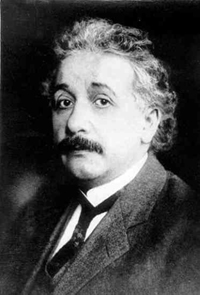
-
EINSTEIN A. / INFELD L., L'évolution des idées en physique, 1936, trad. Champs Flammarion, 1983
-
COHEN I. Bernard, Les origines de la physique moderne (The birth of a new physics, revised and updated, New York, W.W. Norton, 1985), trad. J. Métadier, C. Jeanmougin, trad. Paris, Seuil (Points), 1993
-
SOULEZ Antonia, ed., Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits - Carnap, Hahn, Neurath, Schlick, Waismann, Wittgenstein, Paris P.U.F., 1985, repr. Vrin
-
DUHEM Pierre, La théorie physique, son objet et sa structure, Paris, 1906, repr. Paris, Vrin
-
POPPER Karl, La connaissance objective (Objective knowledge: an evolutionary approach, Oxford, Clarendon, 1972), trad. J.-J. Rosat, Paris, Aubier, 1991, repr. Champs Flammarion
-
POPPER Karl, Conjectures et réfutations (London, Routledge and Kegan Paul, 1963), trad. M-I. et M.B. de Launay, Paris, Payot, 1985
- La science : conjectures et réfutations
- La nature des problèmes philosophiques et leurs racines scientifiques
- Trois conceptions de la connaissance
- Pour une théorie rationaliste de la tradition
- Retour aux Présocratiques
- Note sur Berkeley, précurseur de Mach et d'Einstein
- Critique et cosmologie kantiennes
- Le statut de la science et de la métaphysique
- Pourquoi les calculs logiques et arithmétiques s'appliquent-ils à la réalité ?
- Vérité, rationalité et progrès de la connaissance scientifique Réfutations
- La démarcation entre la science et la métaphysique
- Le langage et la problématique corps / esprit
- Note sur la problématique corps / esprit
- Réflexivité et signification dans le langage ordinaire
- Qu'est-ce que la dialectique ?
- Prédiction et prophétie dans lees scieences sociales
- Opinion publique et principes libéraux
- Utopie et violence
- Considérations d'un optimiste sur l'histoire de notre époque
- Humanisme et raison
-
KUHN Thomas S., La structure des révolutions scientifiques (2nde éd., revue et augmentée, Chicago U.P., 1962), trad. L. Meyer, Paris, Champs Flammarion
- L'acheminement vers la science normale
- La nature de la science normale
- La science normale. Résolution des énigmes
- Priorité des paradigmes
- Anomalie et apparition des découvertes scientifiques
- Crise et apparition des théories scientifiques
- Réponse à la crise
- Nature et nécessité des révolutions scientifiques
- Les révolutions comme transformation dans la vision du monde
- Caractère invisible des révolutions
- Résorption des révolutions
- La révolution, facteur de progrès Postface
-
FEYERABEND Paul, Contre la méthode. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance (1975), trad. B. Jurdant et A. Schlumberger, Paris, Seuil (Points), 1979, repr.
-
HACKING Ian, Representing and intervening: introductory topics in the philosophy of natural science (Concevoir et expérimenter, Paris, Christian Bourgois, 1989), Cambridge U.P., 1983
-
NADEAU Robert, Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, Paris, PUF, 1999
Mode d'emploi : Un livre facile d'accès, mais où il s'agit maintenant de tout comprendre et de tout retenir.
4e de couverture : Deux des plus grands physiciens de notre temps ont écrit ensemble, en 1936 à Princeton, cet ouvrage désormais classique sur L'Evolution des idées en physique. Partant des premiers concepts, de Galilée à Newton, les auteurs décrivent l'évolution des idées dans le domaine de la physique jusqu'aux théories de la relativité et des quanta. C'est donc un véritable tableau des fondements de la physique moderne qui nous est offert ici, dans un style simple et accessible à un large public, même non spécialisé.
Table des matières
1. La naissance de la conception mécanique
Le grand roman à mystères
Le premier fil conducteur
Vecteurs
L'énigme du mouvement
Il reste une piste
La chaleur est-elle une substance ?
Les montagnes russes
Le rapport des valeurs
L'arrière-plan philosophique
La théorie cinétique de la matière
2. Le déclin de la conception mécanique
Les deux fluides électriques
Les fluides magnétiques
La première difficulté sérieuse
La vitesse de la lumière
La lumière comme substance
L'énigme de la couleur
Qu'est-ce qu'une onde ?
La théorie ondulatoire de la lumière
Les ondes lumineuses sont-elles longitudinales ou transversales ?
L'éther et le point de vue mécanique
3. Le champ, la relativité
Le champ comme représentation
Les deux piliers de la théorie du champ
La réalité du champ
Champ et éther
Le système de référence
Ether et mouvement
Temps, distance, relativité
Relativité et mécanique
Le continuum espace-temps
La relativité générale
A l'extérieur et à l'intérieur de
l'ascenseur
La géométrie et l'expérience
La relativité générale et sa
vérification
Champ et matière
4. Les quanta
Continuité-discontinuité
Quanta élémentaires de matière et
d'électricité
Les quanta de lumière
Spectres lumineux
Les ondes de matière
Les ondes de probabilité
La physique et la réalité
Un extrait
La science n'est pas une collection de lois, un catalogue de faits non reliés entre eux. Elle une création de l'esprit humain au moyen d'idées et de concepts librement inventés. (...) La physique a commencé réellement par l'invention de la masse, de la force, et d'un système d'inertie. Tous ces concepts sont des inventions libres.
Les auteurs : Albert Einstein avait autant de génie pour la diffusion de la science que pour sa création. Se référer à ses positions est de bon aloi. Léopold Infeld (1898-1968) était un physicien polonais.
Se procurer ce livre : disponible en poche : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Tout ce qu'il faut savoir, et qui ne se trouve pas partout, sur la naissance de la science moderne. En plus des données historiques, souvent originales, retenir les analyses épistémologiques — et les notions physiques de base, dans le chapitre 5 en particulier.
Table des matières
1. Physique d'une terre en mouvement
2. L'ancienne physique
3. La Terre et l'Univers
4. L'exploration des profondeurs de l'Univers
5. Vers une physique de l'inertie
6. La musique céleste de Képler
7. Le grand dessein : une physique nouvelle
Un extrait
(...) Ces quelques exemples suffisent pour montrer qu'Aristote ne peut être considéré comme un "philosophe en chambre". Il est vrai, cependant, qu'Aristote n'a pas soumis toutes ses affirmations à l'épreuve de l'expérience. Il a, sans aucun doute, cru ce que ses maîtres lui avaient enseigné, tout comme les générations suivantes crurent ce qu'Aristote avait dit. Ce fait est souvent utilisé pour critiquer Aristote et ses successeurs en tant qu'homme de science. Souvenons-nous cependant que les étudiants ne vérifient jamais ne serait-ce que la plupart des affirmations qu'ils rencontrent au hasard de leurs lectures, et encore moins celles figurant dans les manuels scpécialisés. La vie est trop brève.
L'auteur : I. Bernard Cohen (1914-2003) fut l'un des historiens de la physique les plus brillants de son temps, spécialiste de Newton en particulier et du concept de révolution scientifique. Il a enseigné pendant 60 ans à Harvard.
Se procurer ce livre : disponible
en poche : [site
amazon]
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Les textes fondateurs du Cercle de Vienne (le néopositivisme du XXe siècle) sont de grands textes philosophiques qu'il faut connaître de première main. Ils constituent le socle sur lequel s'est construite la philosophie des sciences. Leur tranchant polémique est un peu émousssé, mais leur exigence de compréhension de la radicale singularité de la science reste d'actualité.
4e de couverture : (...) En 1929, les partisans de l'empirisme logique, Carnap, Hahn et Neurath, rendent publique l'intention du Cercle formé à Vienne autour de Schlick : rompre avec la métaphysique au nom d'une méthode logique d'unification des sciences articulée à une définition rigoureuse de ce qu'est un énoncé doué de sens et susceptible de faire avancer la connaissance. (...)
Table des matières
Avant-Propos
Introduction, par A. Soulez
Préhistoire du Cercle de Vienne, par J. Sebestik
I. La conception scientifique du monde. Le Cercle de Vienne
II. Le dépassement de la métaphysique
par l'analyse logique du langage, R. Carnap
III. Vécu, connaissance, métaphysique,
M. Schlick
IV. Entités superflues (le rasoir
d'Occam), H. Hahn
V. Enoncés protocolaires, O. Neurath
VI. Quelques entretiens de Wittgenstein
Note sur Peirce et l'"Aufhebung" de la métaphysique, par C.
Chauviré
Lexique de traduction
Glossaire
Bibliographie
Index
Un extrait
La conception scientifique du monde ne connaît pas d'énigmes insolubles. La clarification des problèmes philosophiques traditionnels conduit en partie à les démasquer comme de pseudo-problèmes, en partie à les transformer en problèmes empiriques, par là même soumis au jugement de la science de l'expérience.
Se procurer ce livre : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Une argumentation
claire et percutante sur
la nature de la science comme simple représentation des
phénomènes, sans accès
privilégié
à cette entité transcendante que serait la
"vérité". Nombreuses pages classiques et analyses
de
référence. L'ambiguïté de
fond (le dogmatisme
métaphysique de Duhem) est ici aussi souvent une richesse
qu'une
limite. On trouve à la fin de ce volume l'article de Duhem
"Physique de croyant".
Les chapitres les plus importants : I: 1-3, II: 4, 6.
Table des matières
1ère partie. L'objet de la théorie physique
1. Théorie physique et
explication métaphysique
2. Théorie physique et
classification naturelle
3. Les théories
représentatives et l'histoire de la physique
4. Les théories abstraites et
les modèles mécaniques
2nde partie. La structure de la théorie physique
1. Quantité et
qualité
2. Des qualités
premières
3. La déduction
mathématique et la théorie physique
4. L'expérience de physique
5. La loi physique
6. La théorie physique et
l'expérience
7. Le choix des hypothèses
Physique de croyant
Un extrait
Une théorie physique n'est pas une explication. C'est un système de propositions mathématiques, déduites d'un petit nombre de principes, qui ont pour but de représenter, aussi simplement, aussi complètement et aussi exactement que possible, un ensemble de lois expérimentales.
L'auteur : Physicien, historien et philosophe des sciences français (1861-1916). Il veut que la "théorie physique" ne soit qu'un système de représentation correspondant au réel, mais pas la vérité du réel lui-même, car pour lui la vérité ne peut venir que de la métaphysique, de la métaphysique vraie, qui est celle du catholicisme. D'où d'étranges prises de position, mais d'une grande fécondité théorique (Quine reprendra en particulier son "holisme").
Se procurer ce livre : Disponible
en ligne au format pdf, gratuitement, à partir de diverses adresses (utiliser Google), au moment de la mise à jour de cette page (2015/08) il était notamment disponible ici : [www.normalesup.org/~sage/Reflexions/Sciences/PDphys.pdf].
- achetable en papier : [site
amazon]
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Les hypothèses et arguments de Popper ne font pas toujours l'unanimité, mais les étudier de près est indispensable. Ce livre est composé d'articles autonomes, on peut sauter les articles ou les passages un peu techniques, pour mieux retenir les plus importants : 1, 3, 6, 7.
4e de couverture : (...) Dans un
style clair et vigoureux,
et fort de cinquante ans de discussion avec physiciens, biologistes et
logiciens, Popper renouvelle l'approche des questions les plus
traditionnelles de la philosophie en choisissant pour fil conducteur
l'événement le plus improbable et le plus
décisif
de l'histoire humaine : le progrès de la science,
qu'il
replace dans le cadre plus général d'une
philosophie de
l'émergence du nouveau.
Rassemblant des textes
rédigés pour la plupart entre 1965 et 1971, La
connaissance objective
est l'ouvrage le plus représentatif de la
"dernière
manière" philosophique de Popper, celui où se
révèlent toutes les implications
métphysiques de
son rationalisme critique ; il y dresse un bilan de ses
idées
mais s'y risque aussi à des conjectures audacieuses.
Table des matières
1. La connaissance conjecturale : ma solution du problème de
l'induction
2. Les deux visages du sens commun : une argumentation en faveur du
réalisme du sens commun et contre la théorie de
la
connaissance du sens commun
3. Une épistémologie sans sujet connaissant
4. Sur la théorie de l'esprit objectif
5. Le but de la science
6. Des nuages et des horloges
7. L'évolution et l'arbre de la connaissance
8. Une conception réaliste de la logique, de la physique et
de l'histoire
9. Commentaires philosophiques sur la théorie de la
vérité de Tarski
L'auteur : Philosophe des sciences (1902-1994), d'origine autrichienne, qui émigre en Nouvelle-Zélande puis en Angleterre. Il a repris la recherche néopositiviste d'une démarcation entre la science et la non-science. Vu son importance, il peut être utile de lire l'article "Popper" de Wikipédia.
Se procurer ce livre : disponible en poche : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Des livres de Popper, il faut en avoir lu plusieurs... Celui-ci est un recueil, très disparate, dans lequel on lira surtout : Introd., 1, 3, 10, 11.
Table des matières
-
Introduction. Des sources de la connaissance et
de l'ignorance
Conjectures
Un extrait
Aux questions proposées, "D'où tenez-vous ce savoir ? Quelle est la source ou le fondement de votre assertion ? Quelles sont les observations qui vous y ont conduit ?", je répondrais par conséquent ainsi : "Je ne sais pas : cette affirmation n'était qu'une pure et simple supposition. Peu importe la source ou les sources qui ont pu lui donner naissance, les sources éventuelles abondent, et il se pourrait fort bien que je n'aie même pas idée de la moitié d'entre elles. D'ailleurs, en tout état de cause, les origines et les généalogies ont peu d'incidence sur la vérité. En revanche, si vous vous intéressez au problème que j'ai tenté de résoudre par le biais d'une assertion provisoire, vous pouvez me seconder dans ma tâche en soumettant mon assertion à une critique aussi rigoureuse que possible ; et si vous parvenez à mettre au point un test expérimental qui, selon vous, est susceptible de réfuter l'affirmation, c'est volontiers et dans toute la mesure de mes forces que je contribuerai à cette entreprise de réfutation."
L'auteur : Philosophe des sciences (1902-1994), d'origine autrichienne, qui émigre en Nouvelle-Zélande puis en Angleterre. Il a repris la recherche néopositiviste d'une démarcation entre la science et la non-science. Vu son importance, il peut être utile de lire l'article "Popper" de Wikipédia.
Se procurer ce livre : [sur site amazon]
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Ce livre a imposé une version du progrès de la science par des crises et une version de l'incommensurabilité entre grandes théories (les "paradigmes") qui a provoqué une crise en philosophie des sciences.
4e de couverture : Thomas S. Kuhn,
physicien, historien et
philosophe des sciences, enseigne au M.I.T. Dans ce livre
célèbre, dont il a revu et corrigé la
traduction
pour cette édition, il a voulu former une nouvelle image de
la
science, comprise à partir de son histoire réelle.
Il met ainsi l'accent sur les
bouleversements de la
pensée scientifique (Copernic, Newton, Lavoisier,
Einstein...),
et étudie ces moments de crise que traverse la science au
cours
de son évolution : il y a révolution
scientifique
lorsqu'une théorie scientifique consacrée par le
temps
est rejetée au profit d'une nouvelle théorie.
Cette
substitution amène généralement un
déplacement des problèmes offerts à la
recherche
et des critères selon lesquels les spécialistes
décident de ce qui doit compter comme problème ou
solution.
Que toute révolution
scientifique soit un
facteur de progrès, c'est ce que démontre
l'auteur
après avoir signalé les conditions requises pour
l'apparition d'une telle crise. Chacune de ces révolutions,
en
fin de compte, transforme non seulement l'imagination scientifique mais
aussi le monde dans lequel s'effectue ce travail scientifique.
Table des matières
-
Préface
Introduction. Un rôle pour l'histoire
L'auteur : T.S. Kuhn (Américain, 1922-1996) a lancé une nouvelle façon d'analyser la science dans ses aspects historiques, concrets, humains. Physicien de formation, il a détecté une anomalie : la science prend soin d'oublier ou de dissimuler son passé. Pourquoi ?
Se procurer ce livre : disponible en poche : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Avec ce livre on passe des études "critiques" sur la science (type Kuhn) à une franche contestation de la rationalité. Feyerabend cherche à provoquer, et ce faisant il invite à trouver de meilleures interprétations sur la nature de la rationalité scientifique. Ne pas répéter de manière dogmatique ses positions.
4e de couverture : Passionné et provocant, ce plaidoyer pour un savoir libertaire, contre tout carcan méthodologique, se fonde sur une analyse minutieuse des coups de force qui ont fondé l'évolution de la science, comme, en particulier, l'argumentation galiléenne. Dévoilant les ruses de l'histoire des sciences, critiquant le dogmatisme caché des épistémologies modernes (Popper et même Lakatos), Feyerabend renouvelle avec véhémence et humour le débat sur la raison.
Extraits
Le seul principe qui n'entrave pas
le progrès est : tout est bon [anything goes :
n'importe quoi peut marcher].
Des théories ne deviennent
claires et "raisonnables" qu'après
un usage prolongé de leurs parties incohérentes.
Tel
préalable, absurde, déraisonnable et non
méthodique, de transforme alors en une
pré-condition
inévitable pour la clarté et le succès
empirique.
La séparation de l'Etat et de
l'Eglise doit
être complétée par la
séparation de l'Etat
et de la Science : la plus récente, la plus
agressive et la
plus dogmatique des institutions religieuses.
L'auteur : Paul Karl Feyerabend (1924-1994) né à Vienne, Autriche, fut officier de la Wehrmacht, artiste polyvalent, et il étudia la physique et la philosophie. Il travaille avec Karl Popper, puis avec son disciple I. Lakatos, mais développe une philosophie des sciences dissidente, qu'il diffuse avec succès par plusieurs best-sellers et un enseignement universitaire international.
Se procurer ce livre : disponible
en
poche [site
amazon].
[< retour début de liste année 2] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Une argumentation serrée contre le "construtivisme" en philosophie des sciences et les autres formes de relativisme social, à partir de remarquables études de cas : le microscope, l'électron, l'éther, la violation de parité. Une vision empiriste (évoluée !) et surtout pragmatiste de la science, synthétique et éclairante.
Table des matières (en anglais)
Introduction: Rationality
Part A. Representing
1. What is scientific realism?
2. Building and causing
3. Positivism
4. Pragmatism
5. Incommensurability
6. Reference
7. Internal realism
8. A surrogate for truth
Break: Reals and representations
Part B. Intervening
9. Experiment
10. Observation
11. Microscopes
12. Speculations, calculation, models, approximations
13. The creation of phenomena
14. Measurement
15. Baconian topics
16. Experimentatin and scientific realism
Further reading
Index
4e de couverture (en anglais)
This is a lively and clearly written introduction to the philosophy of natural science, organized around the central theme of scientific realism. It has two parts. Representing deals with the different philosophical accounts of scientific objectivity and the reality of scientific entities. The views of Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Putnam, Van Fraassen, and others, are all considered. Intervening presents the first sustained treatment of experimental science for many years and uses it to give a new direction to debates about realism.
Hacking illustrates how experimentaion often has a life independent of theory. He argues that although the philosophical problems of scientific realism can not be resolved when put in terms of theory alone, a sound philosophy of experiment provides compelling grounds for a realistic attitude.
A great many scientific examples are described in both parts of the book, which also includes lucid expositions of recent high energy physics and a remarkable chapter on the microscope in cell biology.
L'auteur : Philosophe des sciences d'origine canadienne, il a enseigné à Cambridge, Stanford, Toronto, et au Collège de France à Paris, France. Sa page Wikipédia renvoie à d'intéressants documents en français.
Se procurer ce livre : En français on peut le trouver dans les bonnes bibliothèques (à photocopier et scanner), le mieux est de l'acheter en anglais car la traduction pique souvent les yeux, comme on dit - [en anglais sur amazon]
Mode d'emploi : Le lecteur
très courageux et
très sérieux peut lire les 769 pages de
définitons
dans l'ordre, de "Abduction" à "Weltanschauungen". Il est
plus
raisonnable de feuilleter et de lire les articles qui semblent
intéressants ou fondamentaux, puis d'utiliser ce livre comme
un
dictionnaire. La meilleure façon de l'utiliser est de surfer
de
renvoi en renvoi, car chaque article renvoie à plusieurs
autres.
Avoir bien étudié
ce livre, c'est
maîtriser les bases de la philosophie des sciences la plus
classique, de coloration positiviste, mais sans excès ni de
formalisme ni d'anglophonophilie.
4e de couverture : (...) Notre propos a été d'analyser systématiquement, suivant une stricte approche lexicographique, tous les concepts importants de ce domaine. En nous fondant sur un corpus composé de plusieurs centaines d'ouvrages et d'articles de revue parmi les plus marquants, notre ambition a été de fournir une description rigoureuse de l'espace notionnel de l'épistémologie contemporaine. Ainsi, toutes les publications majeures de langue française et anglaise, de Pierre Duhem à Bas Van Fraassen, ont été compulsées. Et lorsque la chose paraissait utile, nous avons recensé les diverses modulations des concepts examinés.
Un extrait
HOLISME SÉMANTIQUE.
Thèse de Quine (1953) selon laquelle l'unité de signification
empirique est la totalité de la science :
aucun énoncé isolé
n'a de signification empirique, seule la collection complète
des énoncés constituant la science en a une (v.,
par oppos., atomisme sémantique ;
v. aussi sémantique
naïve (Quine). (...)
[les caractères gras renvoient à
d'autres articles de ce Vocabulaire]
L'auteur : Robert Nadeau est un philosophe canadien né en 1944. Après une thèse en France avec Paul Ricoeur, il enseigne à l'université du Québec à Montréal. Sa page sur le site de l'UQAM donne accès à plusieurs de ses publications récentes, essentiellement en épistémologie des sciences sociales et économiques.
Se procurer ce livre : Il se
trouve
dans toutes les
bibliothèques universitaires mais en avoir un exemplaire
chez
soi me semble un bon investissement ; pour cela : [site
amazon].
année 3
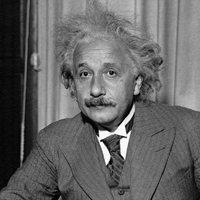
Prologue. Plusieurs choses à partir de ce niveau. 1) Même si vous avez de bons professeurs, c'est votre travail individuel qui devient déterminant et il doit être autonome. 2) Vous devez lire en anglais.
-
BERNARD Claude, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865, repr. Paris, Flammarion (Champs)
-
NAGEL Ernest, The structure of science: problems in logic of scientific explanation, New York, Hartcourt, Brace & World, 1961, repr. Hackett, 1979
- Introduction: science and common sense
- Patterns of scientific explanation
- The deductive pattern of explanation
- The logical character of scientific laws
- Experimental laws and theories
- The cognitive status of theories
- Mechanical explanations and the science of mechanics
- Space and geometry
- Geometry and physics
- Causality and indeterminism in physical theory
- The reduction of theories
- Mechanistic explanations and organismic biology
- Methodological problems of the social sciences
- Explanation and the understanding in the social sciences
- Problems in the logic of historical inquiry
-
LAKATOS Imre, The methodology of scientific research programmes. Philosophical Papers volume 1, ed. John Worral, Gregory Currie, Cambridge U.P., 1978 - trad. partielle (chapitres 1, 2 et 4) : Histoire et méthodologie des sciences. Programmes de recherche et reconstruction rationnelle, Paris, PUF, 1994
-
LORENZ Konrad, Les fondements de l'éthologie, (1978), trad. Champs Flammarion, 1984
-
GOCHET Paul, Quine en perspective, Paris, Flammarion, 1978
-
HOLTON Gerald, L'imagination scientifique (Cambridge U.P., 1978), trad. J.-F. Roberts, E. Allisy, M. Abeillera, Paris, Gallimard, 1981
-
MAYR Ernst, Histoire de la biologie, 2 tomes (The growth of biological thought, Harvard U.P., 1982), trad. M. Blanc, Paris, Fayard
-
FEYNMAN Richard, Lumière et matière. Une étrange histoire (QED, The strange theory of light and matter, Princeton U.P., 1985), trad. F. Balibar, A. Laverne, Points Seuil, 1987
-
PENROSE Roger, L'esprit, l'ordinateur, et les lois de la physique (The Emperor's new mind: concerning computers, minds, and the laws of physics, Oxford U.P., 1989), trad. F. Balibar, C. Tiercelin, trad. Paris, Interéditions, 1992
-
GOODMAN Nelson, Fact, fiction and forecast, University of London, 1955, 3ème éd., Indianapolis, New York, Bobbs-Merrill, 1973 ; trad. Faits, fictions et prédictions, trad. P. Jacob, Paris, Minuit, 1983
Mode d’emploi : Il faut sortir un peu de Galilée et de Newton. La manière dont la vie est abordée par la science doit être comprise, avec ses ambiguïtés, dans ce livre. Ce livre est aussi un classique sur la méthode expérimentale, version XIXe siècle.
Quelques extraits :
Je me propose donc
d'établir que la science
des phénomènes de la vie ne peut pas avoir
d'autres bases
que la science des phénomènes des corps bruts, et
qu'il
n'y a sous ce rapport aucune différence entre les principes
des
sciences biologiques et ceux des sciences physico-chimiques. (...)
Nous ajouterons que le physiologiste ou
le
médecin ne doivent pas s'imaginer qu'ils ont à
rechercher
la cause de la vie ou l'essence des maladies. Ce serait perdre
complètement son temps à poursuivre un
fantôme; Il
n'y a aucune réalité objective dans les mots vie,
mort,
santé, maladie. Ce sont des expressions
littéraires dont
nous nous servons parce qu'elles représentent à
notre
esprit l'apparence de certains phénomènes. (...)
Je suis persuadé que les
obstacles qui
entourent l'étude expérimentale de
phénomènes psychologiques sont en grande partie
dus
à des difficultés de cet ordre ; car,
malgré
leur nature merveilleuse et la délicatesse de leurs
manifestations, il est impossible, selon moi, de ne pas faire entrer
les phénomènes cérébraux,
comme tous les
autres phénomènes des corps vivants, dans les
lois d'un
déterminisme scientifique. (...)
Une autre opinion fausse assez
accréditée et même professée
par de grands
médecins praticiens, est celle qui consiste à
dire que la
médecine n'est pas destinée à devenir
une science,
mais seulement un art, et que par conséquent le
médecin
ne doit pas être un savant, mais un artiste.
Table des matières :
Introduction
1ère partie. Du raisonnement expérimental
1. De l'observation et de
l'expérience
2. De l'idée a priori et du
doute dans le raisonnement expérimental
2e partie. De l'expérimentation chez les êtres
vivants
1. Considérations
expérimentales communes aux êtres vivants et aux
corps bruts
2. Considérations
expérimentales spéciales aux êtres
vivants
3e partie. Applications de la méthode
expérimentale à l'étude des
phénomènes de la vie
1. Exemples d'investigation
expérimentale physiologique
2. Exemples de critique
expérimentale physiologique
3. De l'investigation et de la critique
appliquées à la médecine
expérimentale
4. Des obstacles philosophiques que
rencontre la médecine expérimentale
L’auteur : 1813-1878, médecin et biologiste français. Il fait carrière à la Sorbonne et au Collège de France. Ses travaux portent en particulier sur la digestion.
Se procurer ce livre : Texte électronique intégral : [sur Wikisource] ; en livre de poche : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Un manuel de travail personnel, qui aborde toutes les questions classiques sous un angle "physicaliste" mais assez ouvert. Il permet d'accéder au niveau de connaissances à partir duquel on peut se faire sa propre opinion sur les visions moins "standard" de la science. Bien repérer 3 notions principales, loi, explication, théorie, et leurs liens.
4e de couverture : The Structure of Science has become a highly influential work that is widely invoked in the methodological and philosophical literature. Recent controversies between analytic and historic-sociological approaches to the philosophy of science have not diminished its significance; in fact, it seems to me that the pragmatist component in Nagel's thinking may be helpful for efforts to develop a rapprochement between the contending schools (C.G. Hempel)
Table des matières
Un extrait
Many scientists as well as philosophers have indeed often used the term "real" in an honorific way to express a value judgment and to attribute a "superior" status to the thing asserted to be real.
L'auteur : Philosophe des sciences (1901-1985), né à Prague. Ses parents émigrent aux Etats-Unis, il y fait ses études, notamment à Columbia où il enseignera toute sa vie.
Se procurer ce livre :
disponible
en anglais seulement : [site
amazon]
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Au-delà de Popper, une forme de rationalisme contemporain qui s'efforce de recueillir le meilleur des traditions positivistes et des nouvelles écoles critiques. Retenir la notion de "programme de recherche" en particulier, et le chapitre 5 sur la fonction de Newton dans la mise en place de la normalité scientifique.
4e de couverture : Imre Lakatos' philosophical and scientific papers are published here in two volumes. Volume I brings together his very influential but scattered papers on the philosophy of the physical sciences, and includes one important unpublished essay on the effect of Newton's scientific achievement. (...) Imre Lakatos had an influence out of all proportion to the length of his philosophical career. This collection exhibits and confirms the originality, range and the essential unity of his work.
Table des matières
Editors' introduction
Introduction: science and pseudoscience
1. Falsification and the methodology of scientific research programmes
2. History of science and its rational reconstructions
3. Popper on demarcation and induction
4. Why did Copernicus's research programme supersede Ptolemy's?
5. Newton's effect on scientific standards
References
Lakatos bibliography
Indexes
Un extrait
The history of science refutes both Popper and Kuhn: on close inspection both Popperian crucial experiments and Kuhnian revolutions turn out to be myths: what normally happens is that progressive research programmes replace degenerating ones.
L'auteur : Philosophe des sciences hongrois (1922-1974). Il subit les malheurs de l'Europe centrale (nazisme, communisme) mais il ne quitte son pays qu'en 1956, pour l'Angleterre, où il devient le collègue de Popper à la London School of Economics, sans obtenir la nationalité britannique.
Se procurer ce livre : Il faut
travailler sur l'édition en anglais, qui est disponible : [site
amazon]. On ne lira l'édition en
français
,
incomplète, qui si on a trop de mal en anglais.
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Toujours plus loin de la physique-chimie et des maths, qui ont longtemps obsédé la philosophie des sciences, plus loin encore que la biologie : l'éthologie. C'est l'étude du comportement des animaux, donc pas vraiment une "science humaine", même s'il y a une éthologie humaine. L'un de ses créateurs expose ici la nature épistémologique de cette science. Il faut y comprendre les problèmes spécifiques de l'approche scientifique d'un niveau du réel plus élevé que celui des sciences de la matière.
4e de couverture : A côté de la théorie de la relativité d'Einstein ou de la psychanalyse freudienne, l'éthologie, science dont Kontad Lorenz s'était fait l'initiateur et qui étudie le comportement animal de manière comparative, appartient désormais à la culture occidentale. Oeuvre profondément personnelle, le présent volume est une véritable " somme " de la pensée de Lorenz. Dans l'introduction, Lorenz illustre à grands traits les directions du développement de l'éthologie et ses propres positions théoriques. La première partie, consacrée aux aspects méthodologiques, essaie de tracer les frontières sûres de l'étude comparée du comportement et en établit les règles rigoureuses. Puis le concept de système, ou plutôt d'unité fonctionnelle indivisible révèle toute sa fécondité pour l'étude de la nature. La conclusion affronte les modifications du comportement obtenues par l'apprentissage : s'il est vain de tenter une explication à fondement unique, comme le voudraient les behaviouristes, il est indubitable que même ces " programmes ouverts " contiennent une quantité notable d'information acquise par l'espèce. Accusé d'" innéisme " excessif, Lorenz se défend avec vigueur. Il survole ici les aspects du comportement humain, mais les résultats de l'éthologie animale ont une portée si générale que la référence transparaît. L'édifice lumineux mais fragile de notre rationalité, nous avertit Lorenz, repose sur un terrain d'instincts primordiaux que nous partageons avec des créatures bien plus primitives dans l'échelle de l'évolution et avec qui nous devons compter.
L'auteur : Biologiste autrichien
(1903-1909). Né et
formé à Vienne, il adhère au nazisme :
il sera
capturé et déporté par les Russes de
1942 et 1948,
et il ne cessera ensuite de regretter cet engagement. Il
reçoit
en 1973 le prix Nobel de physiologie ou médecine pour la
co-invention de sa discipline, l'éthologie. Sa
capacité
à vivre en communauté avec les animaux est
immortalisée par des photos où il est suivi par
des oies
cendrées qui le prennent pour leur mère
(validation de sa
théorie de l'empreinte)...
Son autobiographie en anglais
est accessible sur le site des Nobels.
Se procurer ce livre : disponible en poche : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : A un moment ou à un autre, il va falloir se mettre à Quine, faire connaissance d'abord, le lire et l'approfondir ensuite. Le minimum de Quine à connaître en philosophie des sciences est intelligemment présenté par ce livre.
4e de couverture : Si l'on en croit l'empirisme logique du début, le savoir se répartit en deux groupes bien distincts d'énoncés, les énoncés d'observation et les énoncés théoriques, avec, pour les relier, quelques relations de confirmation. Quine rejette cette image de la science. Radicalisant les vues de Duhem, il écrit que "les énoncés scientifiques affrontent le tribunal de l'expérience, non pas isolément, mais comme un corps constitué". Comment empêcher, dans ces conditions, que la métaphysique irresponsable ne s'insinue sous le couvert de la théorie devenue omniprésente ? La réponse de Quine est nette : renvoyant dos à dos le réalisme qui postule l'existence d'une entité séparée derrière chaque terme théorique et l'instrumentalisme qui nie cette existence dans tous les cas, il formule un critère permettant de localiser, puis de mesurer, la charge ontologique des théories. (...)
Table des matières
1. La critique de l'épistémologie empiriste
2. De l'épistémologie du fondement à
la psychologie de la genèse
3. La théorie de la signiifcation
4. L'indétermination de la traduction
5. L'ontologie de Quine
6. (suite)
7. La philosophie de la logique et des mathématiques
8. Logique modale et essentialisme
9. La logique et la théorie de l'intentionalité
Index
Bibliographie
Un extrait
La tâche n'est pas de "justifier" la science à l'aide d'une philosophie qui lui serait antérieure. C'est à l'intérieur de la science que se posent les problèmes épistémologiques.
L'auteur : Paul Gochet (né en 1932) enseignait la logique, la philosophie du langage et de la connaissance à l'université de Liège, Belgique.
Se procurer ce livre :
disponible [site
amazon]
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Le livre est composé de chapitres autonomes. Une méthode d'histoire des sciences qui complète admirablement les interprétations trop formalistes. Analyse remarquable des origines philosophiques de la complémentarité chez Niels Bohr, exposé détaillé de l'épistémologie d'Einstein, bons exemples sur les facteurs extra-scientifiques dans la découverte scientifique
4e de couverture : Son expérience de physicien et de pédagogue, autant que ses recherches historiques, mènent G. Holton à révoquer en doute l'image de la science — celle que s'en font ses partisans et ses détracteurs, et à laquelle souscrivent les scientifiques eux-mêmes. La construction inductive-déductive de l'empirisme rationaliste n'intervient que dans le contexte de justification, seul pris en compte par la "science publique". Mais le contexte de découverte met en jeu les options personnelles du chercheur, son intuition expérimentale et théorique — la "science privée", faisant fond sur un répertoire relativement stable de "thêmata" d'ordre esthétique, informant l'image du monde mise en place par la science : la création scientifique est aussi oeuvre d'imagination.
Table des matières
Introduction
1. Les thêmata dans la pensée scientifique
2. L'univers de J. Képler : physique et
métaphysique
3. Les racines de la complémentarité
4. Aux origines de la théorie de la relativité
restreinte
5. Einstein et la quête de l'image du monde
6. L'élaboration théorique selon le
modèle einsteinien
7. Le groupe de Fermi et le rétablissement des positions de
l'Italie en physique
8. Des modèles permettant de comprendre le
développement de la recherche
9. L'imagination scientifique : dionysiens et apolliniens
10. De la psychologie des hommes de science et de leur
intérêt pour les problèmes sociaux
Sources
Index
Un extrait
... une nation si fortement tournée vers la course aux armements. (On peut supposer que, si demain on découvrait la manière de détruire les multitudes en récitant des poèmes, les physiciens devraient se retirer dans les mansardes, et on racolerait les poètes en leur donnant les locaux des laboratoires.)
L'auteur : Gerald Holton est à la fois Professeur de physique et Professeur de philosophie des sciences à Harvard.
Se procurer ce livre : En bibliothèque, car il est indisponible à la vente. Mérite la photocopie, ou mieux le scan, partageable. A moins que... mais oui bien sûr ! Just do it in English, from here: [amazon web site].
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Toute l'histoire d'une science, la biologie, depuis sa préhistoire. Mayr est un des auteurs de la "théorie synthétique de l'évolution", à l'origine aujourd'hui de diverses philosophies et épistémologies darwiniennes. L'angle historique de ce livre lui permet une argumentation progressive et particulièrement percutante. De nombreuses études de cas très utiles en philosophie des sciences.
4e de couverture : On n'a pas
toujours su qu'il y avait sur
la Terre des dizaines de milliers d'espèces d'animaux et de
plantes: ce sont les grands voyageurs d'exploration du XVIIIe
siècle qui l'ont révélé. On
n'a pas
toujours su que des animaux et des plantes totalement
différents
de ceux d'aujourd'hui avaient vécu dans les temps
préhistoriques : les restes des dinosaures n'ont
été trouvés qu'au début du
XIXe
siècle. On n'a pas toujours su qu'il y avait des
êtres
vivants invisibles à l’œil nu : les
microbes ont
été découverts en 16'74
grâce à
l'invention du microscope. On n'a pas toujours su que les tissus des
animaux et des végétaux étaient
composés
d'unités fondamentales : les cellules (cette connaissance a
été acquise dans les années 1830).
C'est l'histoire de ces
découvertes
scientifiques que retrace le livre d'Ernst Mayr. Mais c'est aussi et
surtout l'histoire des idées émises par les
biologistes
pour expliquer la genèse du vivant, idées qui ont
abouti
à la révolution intellectuelle lancée
par Charles
Darwin en 1859 : les espèces d'animaux et de plantes n'ont
pas
été créées à
l'origine du monde et
ne sont pas restées fixes, comme le dit la Bible. Elles
changent
constamment et engendrent de nouvelles espèces. C'est ainsi,
par
exemple, que l'espèce humaine est apparue il y a quelques
millions d'années, issue d'une espèce de singe
ancestrale.
Table des matières
(tome 1)
Préface
1. Comment faire l'histoire de la biologie
2. La place de la biologie dans les
sciences et sa structure conceptuelle
3. Les contextes intellectuels et
l'histoire de la biologie
4. La macrotaxinomie, science de la
classification
5. La formation de groupes issus
d'ancêtres communs
6. La microtaxinomie, science de
l'espèce
7. Les premières conceptions
non-évolutionnistes sur les origines
8. L'évolutionnisme avant
Darwin
9. Charles Darwin
10. Les preuves de l'évolution
et de la descendance selon Darwin
(tome2)
11. La cause de
l'évolution : la sélection naturelle
12. Diversité et
synthèse évolutionniste
13. Après la
synthèse
14. Premières
théories et premières expériences de
croisement
15. Les cellulees germinales, vectrices
de l'hérédité
16. La nature de
l'hérédité
17. L'épanouissement de la
génétaique mendélienne
18. Les théories du
gène
19. La base chimique de
l'hérédité
20. Epilogue : vers une science de la
nature
Glossaire, Bibliographie, Index
L'auteur : Biologiste d'origine allemande (1904-2005). Il est d'abord un spécialiste des oiseaux, qui s'installe aux Etats-Unis en 1931. Il enseigne à Harvard de 1953 à 1975, et il publie de très nombreux livres et articles juqu'à sa mort, centenaire.
Se procurer ce livre : En français a été pubié en poche mais il est... épuisé. Se trouve donc en bibliothèque ou d'occasion. En anglais [amazon web site].
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Feynman expose en version grand public la théorie quantique la plus centrale, l'électrodynamique (en appelant les vecteurs des "flèches", par exemple : au lieu de se gargariser de la complexité formelle, il la surplombe). Il fait sentir à quoi ressemble ce type de physique, et en même temps règle ses comptes avec les interprétations fantaisistes ou faussement profondes de la physique. La plupart des philosophes n'apprécieront pas les thèses de Feynman sous leur forme directe, mais elles donnent une assise de réflexion sans aucun équivalent.
4e de couverture : L'électrodynamique quantique, prototype des théories de la physique moderne, devient un jeu d'enfant quand elle est expliquée par un de ses auteurs, Richard Feynman. En analysant "avec des petites flèches" comment la lumière se réfléchit sur les miroirs et pourquoi les bulles de savon présentent des irisations, il montre que les notions les plus difficiles sont explicables sans aucun formalisme mathématique et que leur sens profond est à la portée de tous. Un sommet de la vulgarisation scientifique.
Table des matières
1. Introduction
2. Les photons : des particules de lumière
3. Les électrons et leurs interactions
4. Questions en suspens
Index
Un extrait
Je vais vous décrire la Nature ; mais si cela ne vous plaît pas, vous allez avoir du mal à comprendre. C'est un problème que les physiciens ont plus d'une fois rencontré. A la longue, ils ont compris que le fait qu'une théorie leur plaise ou pas n'avait pas à entrer en ligne de compte. Ce qui est important, c'est que la théorie en question permette des prédictions qui soient en accord avec l'expérience. La question n'est pas de savoir si telle théorie est agréable du point de vue philosophique, ou si elle est facile à comprendre, ou si elle est acceptable du point de vue du sens commun. La théorie de l'électrodynamique quantique nous fournit une description de la Nature qui est absurde du point de vue du sens commun. Mais elle est en accord parfait avec l'expérience. J'espère donc que vous accepterez la Nature telle qu'Elle est : absurde.
L'auteur : Richard Feynman (1918-1988) est un physicien américain de génie, tant pour la création conceptuelle en physique que pour la diffusion de la science. Il a été une sorte d'Einstein de la seconde moitié du XXe siècle. Son manuel de physique est utilisé dans le monde entier. Feynman ne séparait pas le savoir de sa diffusion au niveau élémentaire : ce que je ne suis pas capable d'expliquer dans un cours de première année, c'est que je ne le maîtrise pas assez, disait-il.
Se procurer ce livre :
disponible
en poche [site
amazon]
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Les
théories de Penrose sont loin de
faire l'unanimité, mais ce livre permet de s'initier aux
domaines frontières les plus intéressants,
particulièrement sur les questions de l'intelligence
artificielle et de la nature quantique de l'univers. Livre utile comme
source sur des thèmes dont on parle souvent très
approximativement : machine de Turing, théorème
de
Gödel, fractales, étrangetés quantiques,
espace-temps relativiste...
Le livre contient des
éléments
mathématiques et physiques assez précis, mais le
lecteur
purement philosophe peut les passer sans encombre.
4e de couverture : Les lois de la matière et de l'esprit seront-elles un jour unifiées ? L'ordinateur est-il la porte ouverte sur ce nouveau monde de la conscience et de la connaissance ? Face à ces questions nées du progrès des sciences et à la vision réductionniste de certains défenseurs de l'intelligence artificielle, un grand physicien et mathématicien ose proclamer que le roi est nu : il soutient que la physique est encore loin de pouvoir apporter le moindre élément de réponse et que le problème se situe tout autant du côté de la théorie quantique, dont nul n'ignore qu'elle est incomplète, que du côté de la relativité générale.
Table des matières
1. Un ordinateur peut-il avoir un esprit ?
2. Algorithmes et machines de Turing
3. Mathématiques et réalité
4. Vérité, démonstration et intuition
5. Le monde classique
6. Mystère et magie quantiques
7. Cosmologie et flèche du temps
8. A la recherche de la gravitation quantique
9. Cerveaux réels et modèles du cerveau
10. Où réside la physique de l'esprit ?
Epilogue
Bibliographie
Index
Un extrait
Afin de mieux fixer les idées, je propose de distinguer trois grandes catégories parmi les théories physiques fondamentales, que je désignerai par l'un des qualificatifs suivants : 1) sublime, 2) utile, 3) provisoire.
L'auteur : Roger Penrose (né en 1931) est un mathématicien-physicien britannique (Oxford), dont les travaux fondamentaux en physique n'ont d'égal que la notoriété de ses livres de philosophie, aux positions très originales.
Se procurer ce livre : La traduction française est épuisée mais devrait se trouver en bibliothèque, encore une fois à scanner et à partager. As usual une édition de poche en anglais est facilement accessible : [amazon web site].
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : De la philosophie analytique appliquée à la connaissance scientifique : mobilise des moyens compliqués pour poser des problèmes compliqués, qui n'ont pas de solution. Mais qui donnent lieu à des discussions au fil desquelles les théories de l'induction et de la prédiction se sont améliorées.
4e de couverture : "Quite possibly the best book by a philosopher in the last twenty years. It changed, probably permanently, the way we think about the problem of induction, and hence about a constellation of related problems like kearning and the nature of rational decision." (J.A. Fodor)
Table des matières
Introduction
Predicament - 1946
1. The problem of counterfactual conditionals
1. The problem in general
2. The problem of relevant conditions
3. The problem of law
Project - 1953
2. The passing of the possible
1. Foreword: on the philosophic conscience
2. Counterfactuals
3. Dispositions
4. Possibles
5. The passing
3. The new riddle of induction
1. The old problem of induction
2. Dissolution of the old problem
3. The constructive task of confirmation
theory
4. The new riddle of induction
5. The pervasive problem of projection
4. Prospects for a theory of projection
1. A new look at the problem
2. Actual projections
3. Resolution of conflicts
4. Presumptive projectibility
5. Comparative projectibility
6. Survey and speculations
Un extrait
As a first approximation then,
we
might say that a law is a true sentence used for making predictions.
(...)
I want only to emphasize the Humean idea
that rather
than a sentence being used for prediction because it is a law, it is
called a law because it is used for prediction. (...)
Discourse, even about possibles, need not
transgress
the boundaries of the actual world. What we often mistake for actual
world is one particular description of it. And what we mistake for
possible worlds are just equally true descriptions in other terms. (...)
We have so far neither any answer nor any
promising
clue to an answer to the question what distinguishes lawlike or
confirmable hypotheses from accidental or non-confirmable ones; and
what may at first have seemed a minor technical difficulty has taken
now the stature of a major obstacle to the development of a
satisfactory theory of confirmation. It is this problem that I call the
new riddle of induction.
L'auteur : Philosophe américain (1906-1998). Formé à Harvard, il développe une compétence à la fois en philosophie analytique et en esthétique. Ses thèses partent souvent d'idées de Quine.
Se procurer ce livre :
disponible
en original anglais : [site
amazon] et en
traduction française : [site
amazon
].
[< retour début de liste année 3] [<<< retour liste années]
année 4
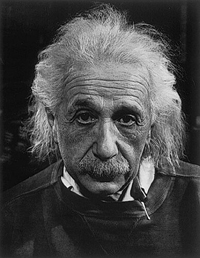
Prologue. A ce niveau de votre formation, vous avez repéré les domaines qui vous intéressent et vous êtes lancé dans leur exploration. En parallèle avec ce travail de plus en plus individualisé, il est important de renforcer une culture assez généraliste en philosophie des sciences, selon la loi pyramidale du savoir : pour monter très haut il faut avoir une base très large.
-
SCHLICK Moritz, General theory of Knowledge (Allgemeine Erkenntnislehre, Berlin, 1918, 1925), trad. A.E. Blumberg, New York, Springer, Library of Exact Philosophy, 1974
-
CURD Martin, COVER J.A., Philosophy of science: the central issues, New York, W.W. Norton, 1998
-
LAUDAN Larry, Progress and its problems: towards a theory of scientific growth, Berkeley, University of California Press, 1977 - La dynamique de la science, trad. P. Miller, Bruxelles, Mardaga, 1987
-
KITCHER Philip, The advancement of science: science without legend, objectivity without illusions, New York, Oxford U.P., 1993
-
VAN FRAASSEN Bas, The scientific image, Oxford, Clarendon, 1980
-
DUPRÉ John, The disorder of things: metaphysical foundations of the disunity of science, Harvard University Press, 1993
-
SWARTZ Norman, The concept of physical law, Cambridge U.P., 1985
-
GELL-MANN Murray, Le quark et le jaguar. Voyage au coeur du simple et du complexe, (1994) Champs Flammarion
-
DENNETT Daniel C., Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life, New York, Simon & Schuster, 1995, repr. Penguin Books, 1995 - Darwin est-il dangereux ?, trad. P. Engel, Paris, Odile Jacob
-
ZAMMITO John H., A nice derangement of epistemes: post-positivism in the study of science from Quine to Latour, Chicago U.P., 2003
Mode d'emploi : Moritz Schlick n'est pas le plus connu des auteurs du Cercle de Vienne mais c'est celui qui se lit le mieux un siècle après. Il faut étudier à sa source l'empirisme viennois, dans ce livre rarement égalé en termes de clarté, solidité, profondeur.
4e de couverture : "Thinking does not create all the relations of reality: it has no form that it might imprint on reality. And reality permits no forms to be imprinted upon itself, becasue it already processes form." In this exciting, acutely reasoned treatise, Schlick thoroughly demolishes Kant's arguments for synthetic a priori knowledge, expounds the most persuasive solution ever conceived to the mind-body problem, and prepares the way for the modern analytic movement. Although logical positivism (which schlick founded several years after writing General Theory of Knowledge) is now viewed as untenable, admiration for the General Theory itself, with its anticipations of Popper, Russell, Hempel, and others, continues to grow.
Table des matières
Introduction, by H. Feigl and A.E. Blumberg
I. The nature of knowledge
1. The meaning of the theory of knowledge
2. Knowing in everyday life
3. Knowing in science
4. Knowing by means of images
5. Knowing by means of concepts
6. The limits of definition
7. Implicit définitions
8. The nature of judgments
9. Judging and knowing
10. What is truth?
11. Definitions, conventions and
empirical judgments
12. What knowledge is not
13. On the value of knowledge
II. The problems of thought
14. The interconnectedness of knowledge
15. The analytic character of rigorous
inference
16. A skeptical considerationof analysis
17. The unity of consciousness
18. The relationship of the psychological
to the logical
19. On self-evidence
20. So-called inner perception
21. Verification
III. Problems of reality
A. The positing of the real
22. Formulating the question
23. Naive and philososphical viewpoints
on the question of reality
24. The temporality of the real
25. Things-in-themselves and the notion
of immanence
26. Critique of the notion of immanence
B. Knowledge of the real
27. Essence and "appearance"
28. The subjectivity of time
29. The subjectivity of space
30. The subjectivity of the sense
qualities
31. Quantitative and qualitative knowledge
32. The physical and the mental
33. More on the psychophysical problem
34. Objections to parallelism
35. Monism, dualism, pluralism
C. The validity of knowledge of reality
36. Thinling and being
37. Knowing and being
38. Is there a pure intuition?
39. Are there pure forms of thought?
40. On categories
41. On inductive knowledge
Index
L'auteur : Philosophe allemand (1882-1936). Il étudie la physique, mais publie aussi sur l'esthétique, puis il s'installe à Vienne où il enseigne la philosophie des sciences. Il y participe à la fondation du Cercle de Vienne et se lie avec Wittgenstein.
Se procurer ce livre : On trouve
dans les bonnes
bibliothèques universitaires la version anglaise ou la
version
allemande. La version anglaise est plus ou moins disponible en occasion
[site
amazon], et l'original allemand est disponible [sur site amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Un gros (1379 pages) manuel et recueil de textes, qui permet sans bouger de chez soi d'effectuer un semestre d'immersion dans le monde universitaire américain. Le choix des articles (des classiques mais pas seulement) et leur présentation sont exemplaires. A étudier de près pour rompre définitivement avec tout provincialisme.
Table des matières
Preface
General Introduction
1 Science and Pseudoscience
INTRODUCTION
Karl Popper, Science: Conjectures and
Refutations
Thomas S. Kuhn, Logic of Discovery or
Psychology of Research?
Imre Lakatos, Science and Pseudoscience
Paul R. Thagard, Why Astrology Is a
Pseudoscience
Michael Ruse, Creation-Science Is Not
Science
Larry Laudan, Commentary: Science at the
Bar--Causes for Concern
Michael Ruse, Response to the Commentary:
Pro Judice
COMMENTARY
2 Rationality, Objectivity, and Values in Science
INTRODUCTION
Thomas S. Kuhn, The Nature and Necessity
of Scientific Revolutions
Thomas S. Kuhn, Objectivity, Value
Judgment, and Theory Choice
Ernan McMullin, Rationality and Paradigm
Change in Science
Larry Laudan, Dissecting the Holist
Picture of Scientific Change
Helen E. Longino, Values and Objectivity
Kathleen Okruhlik, Gender and the
Biological Sciences
COMMENTARY
3 The Duhem-Quine Thesis and Underdetermination
INTRODUCTION
Pierre Duhem, Physical Theory and
Experiment
W. V. Quine, Two Dogmas of Empiricism
Donald Gillies, The Duhem Thesis and the
Quine Thesis
Larry Laudan, Demystifying
Underdetermination
COMMENTARY
4 Induction, Prediction, and Evidence
INTRODUCTION
Peter Lipton, Induction
Karl Popper, The Problem of Induction
Wesley C. Salmon, Rational Prediction
Carl G. Hempel, Criteria of Confirmation
and Acceptability
Laura J. Snyder, Is Evidence Historical?
Peter Achinstein, Explanation v.
Prediction: Which Carries More Weight?
COMMENTARY
5 Confirmation and Relevance: Bayesian Approaches
INTRODUCTION
Wesley C. Salmon, Rationality and
Objectivity in Science or Tom Kuhn Meets Tom Bayes
Clark Glymour, Why I Am Not a Bayesian
Paul Horwich, Wittgensteinian Bayesianism
COMMENTARY
6 Models of Explanation
INTRODUCTION
Rudolf Carnap, The Value of Laws:
Explanation and Prediction
Carl G. Hempel, Two Basic Types of
Scientific Explanation
Carl G. Hempel, The Thesis of Structural
Identity
Carl G. Hempel, Inductive-Statistical
Explanation
David-Hillel Ruben, Arguments, Laws, and
Explanation
Peter Railton, A Deductive-Nomological
Model of Probabilistic Explanation
COMMENTARY
7 Laws of Nature
INTRODUCTION
A. J. Ayer, What Is a Law of Nature?
Fred I. Dretske, Laws of Nature
D. H. Mellor, Necessities and Universals
in Natural Laws
Nancy Cartwright, Do the Laws of Physics
State the Facts?
COMMENTARY
8 Intertheoretic Reduction
INTRODUCTION
Ernest Nagel, Issues in the Logic of
Reductive Explanations
Paul K. Feyerabend, How to Be a Good
Empiricist--A Plea for Tolerance in Matters Epistemological
Thomas Nickles, Two Concepts of
Intertheoretic Reduction
Philip Kitcher, 1953 and All That: A Tale
of Two Sciences
COMMENTARY
9 Empiricism and Scientific Realism
INTRODUCTION
Grover Maxwell, The Ontological Status of
Theoretical Entities
Bas C. van Fraassen, Arguments Concerning
Scientific Realism
Alan Musgrave, Realism versus
Constructive Empiricism
Larry Laudan, A Confutation of Convergent
Realism
James Robert Brown, Explaining the
Success of Science
Ian Hacking, Experimentation and
Scientific Realism
David B. Resnik, Hacking's Experimental
Realism
Arthur Fine, The Natural Ontological
Attitude
Alan Musgrave, NOA's Ark--Fine for Realism
COMMENTARY
Glossary
Bibliography
Name Index
Subject Index
Les auteurs : Les auteurs du recueil sont deux enseignants de Purdue University (West Lafayette, Indiana). Les auteurs des articles sont : un annuaire de la philosophie des sciences du XXe siècle dans le monde.
Se procurer ce livre : Il peut se trouver en bibliothèque, mais c'est un investissement qui se justifie [sur site amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : L. Laudan pourrait bien être l'un des esprits les plus brillants et les plus originaux de sa génération de philosophes américains des sciences. Pour faire simple on pourrait le décrire par deux adjectifs : impertinent et pertinent. Les études de cas de ce livre sont de très utiles références argumentatives
Table des matières
Preface
Part 1. A model of scientific progress
1. The role of empirical problems
2. Conceptual problems
3. From theories to research traditions
4. Progress and revolution
Part II. Applications
5. History and philosophy of science
6. The history of ideas
7. Rationality and the sociology of
knowledge
Un extrait
Unsolved problems generally count as genuine problems only when they are no longer unsolved.
L'auteur : Philosophe américain des sciences, né au Texas en 1941, et qui a fait sa carrière universitaire à Virginia Tech puis au Texas.
Se procurer ce livre : Sont disponibles à la fois la traduction française [sur site amazon] et l'original en anglais [amazon web site].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : A la fois un classique de la philosophie des sciences actuelle, sur la question centrale du progrès des théories, et une analyse très critique de la "Légende" de la science, qu'il définit dans son premier chapitre. Solidité des références à la science contemporaine et aucun abus de formalisme : que du bon.
4e de couverture : During the last three decades, reflections on the growth of scientific knowledge have inspired historians, sociologists, and some philosophers to contend that scientific objectivity is a myth. In this book, Kitcher attempts to resurrect the notions of objectivity and progress in science by identifying both the limitations of idealized treatments of growth of knowledge and the overreactions to philosophical idealizations. Recognizing that science is done not by logically omniscient subjects working in isolation, but by people with a variety of personal and social interests, who cooperate and compete with one another, he argues that, nonetheless, we may conceive the growth of science as a process in which both our vision of nature and our ways of learning more about nature improve.
Table des matières
1. Legend's legacy
2. Darwin's achievement
3. The microstructure of scientific change
4. Varieties of progress
5. Realism and scientfic progress
6. Dissolving rationality
7. The experimental philosophy
8. The organization of cognitive labor
Bibliography
Index
Un extrait
Legend celebrated science. Depicting the sciences as directed at noble goals, it maintained that those goals have been ever more successfully realized. For explanations of the successes, we need look no further than the exemplary intellectual and moral qualities of the heroes of legend, the great contributors to the great advances.
L'auteur : Philosophe des sciences d'origine britannique, né en 1947. Après un PhD à Princeton, il a enseigné aux USA, où il est aujourd'hui à Columbia (New York). Ses domaines d'intérêt couvrent la science de type physico-mathématique, mais aussi la biologie, et il prend en compte les questions métaphysiques et éthiques qui se posent dans ces domaines
Se procurer ce livre : [sur site amazon]
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : La position de Van Fraassen, "l'empirisme constructif", est l'un des possibles les plus discutés de la philosophie actuelle des sciences. C'est aussi un moyen de comprendre les points forts et faibles des options aujourd'hui en présence.
4e de couverture : The aim of The Scientific Image is to develop an empiricist alternative to both logical positivism and scientific realism. Against positivism, the author insists on a literal interpretation of the language of science, and on an irreducibly pragmatic dimension of theory acceptance. Against realism he argues that the central aim of science is empirical adequacy, and that the only belief involved in the acceptance of a scientific theory is belief that the theory fits the observable phenomena.
Table des matières
1. INTRODUCTION
2. ARGUMENTS CONCERNING SCIENTIFIC REALISM
1. Scientific Realism and Constructive
Empiricism
1.1
Statement of Scientific Realism
1.2
Alternatives to Realism
1.3
Constructive Empiricism
2. The Theory/Observation `Dichotomy'
3. Inference to the Best Explanation
4. Limits of the Demand for Explanation
5. The Principle of the Common Cause
6. Limits to Explanation: a Thought
Experiment
7. Demons and the Ultimate Argument
3. TO SAVE THE PHENOMENA
1. Models
2. Apparent Motion and Absolute Space
3. Empirical Content of Newton's Theory
4. Theories and their Extensions
5. Extensions: Victory and Qualified
Defeat
6. Failure of the Syntactic Approach
7. The Hermeneutic Circle
8. Limits to Empirical Description
9. A New Picture of Theories
4. EMPIRICISM AND SCIENTIFIC METHODOLOGY
1. Empiricist Epistemology and Scepticism
2. Methodology and Experimental Design
2.1 The
Roles of Theory
2.2
Measuring the Charge of the Electron
2.3 Boyd on
the Philosophical Explanation of Methodology
2.4
Phenomenology of Scientific Activity
3. The Conjunction Objection
4. Pragmatic Virtues and Explanation
4.1 The
Other Virtues
4.2 The
Incursion of Pragmatics
4.3 Pursuit
of Explanation
5. THE PRAGMATICS OF EXPLANATION
1. The Language of Explanation
1.1 Truth
and Grammar
1.2 Some
Examples
2. A Biased History
2.1 Hempel:
Grounds for Belief
2.2 Salmon:
Statistically Relevant Factors
2.3 Global
Properties of Theories
2.4 The
Difficulties: Asymmetries and Rejections
2.5
Causality: the Conditio Sine Qua Non
2.6
Causality: Salmon's Theory
2.7 The
Clues of Causality
2.8
Why-questions
2.9 The
Clues Elaborated
3. Asymmetries of Explanation: A Short
Story
3.1
Asymmetry and Context: the Aristotelian Sieve
3.2 `The
Tower and the Shadow'
4. A Model for Explanation
4.1
Contexts and Propositions
4.2
Questions
4.3 A
Theory of Why-questions
4.4
Evaluation of Answers
4.5
Presupposition and Relevance Elaborated
5. Conclusion
6. PROBABILITY: THE NEW MODALITY OF SCIENCE
1. Statistics in General Science
2. Classical Statistical Mechanics
2.1 The
Measure of Ignorance
2.2
Objective and Epistemic Probability Disentangled
2.3 The
Intrusion of Infinity
3. Probability in Quantum Mechanics
3.1 The
Disanalogies with the Classical Case
3.2 Quantum
Probabilities as Conditional
3.3 Virtual
Ensembles of Measurements
4. Towards an Empiricist Interpretation
of Probability
4.1
Probability Spaces as Models of Experiments
4.2 The
Strict Frequency Interpretation
4.3
Propensity and Virtual Sequences
4.4 A Modal
Frequency Interpretation
4.5
Empirical Adequacy of Statistical Theories
5. Modality: Philosophical Retrenchment
5.1
Empiricism and Modality
5.2 The
Language of Science
5.3
Modality without Metaphysics
7. GENTLE POLEMICS
NOTES
INDEX
Un extrait
Science aims to give us theories which are empirically adequate; and acceptance of a theory involves a belief only that it is empirically adequate. This is the statement of the anti-realist position I advocate; I shall call it constructive empiricism.
L'auteur : Philosophe des sciences né aux Pays-Bas en 1941. Ses parents émigrent en Amérique du nord où il finit ses études (Canada, puis USA). Il enseigne depuis 1982 à Princeton. Sa page personnelle à Princeton donne une idée de sa personnalité originale.
Se procurer ce livre : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : John Dupré s'intéresse aux soubassements et implications métaphysiques (ce qui ne lui pose aucun problème) des sciences : il retouve du coup la profondeur de vue et la liberté de manoeuvre d'un Quine, rarement égalée. Sa version d'un réel foncièrement désordonné, dans lequel se construit une science qui fait de son mieux, est susceptible de répondre point par point aux meilleures épistémologies néopositivistes et aux meilleures critiques instrumentalistes. Sa critique du réductionnisme, appliquée notamment aux sciences de la vie, est particulièrement d'actualité.
4e de couverture : The great dream of philosophers and scientists for millennia has been to give us a complete account of the order of things. A powerful articulation of such a dream in this century has been found in the idea of a unity of science. With this manifesto, John Dupré systematically attacks the ideal of scientific unity by showing how its underlying assumptions are at odds with the central conclusions of science itself. In its stead, the author gives us a metaphysics much more in keeping with what science tells us about the world.
Table des matières
Introduction
I. Natural kinds and essentialism
1. Natural
kinds
2. Species
3. Essences
II. Reductionism
4.
Reductionism and materialism
5.
Reductionism in biology I : Ecology
6.
Reductionism in biology II : Genetics
7.
Reductionism and the mental
III. The limits of causality
8.
Determinism
9.
Probabilistic causality
IV. Some consequences of disorder
10. The
disunity of science
11. Science
and values
Bibliography
Index
L'auteur : John Dupré est un Britannique, même si il a fait une partie de ses études aux USA et a longtemps enseigné à Stanford. Il est aujourd'hui en Angleterre, à l'université d'Exeter (pages personnelles).
Se procurer ce livre : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Sur une notion essentielle (la notion de loi) un livre clair, sain, savant. Méditer le postscript sur la "coïncidence cosmique".
4e de couverture : The Concept of Physical Law is an original and creative defense of the Regularity theory of physical law, the concept that physical laws are nothing more than descriptions of whatever universal truths happen to be instanced in nature. Professor Swartz clearly identifies and analyzes the arguments and intuitions of the opposing Necessitarian theory, and argues that the standard objection to the Regularity theory turns on a mistaken view of what Regularists mean by ‘physical impossibility’; that it is impossible to construct an empirical test that can distinguish between events Necessitarians call ‘mere accidents’ and those they call ‘nornologically necessary’, and that the Necessitarian theory cannot account fot human beings’ free wills. Other topics in this important work include: the distinction between instrumental scientific laws and true physical laws; the distinction between failure and doom; potentialities; miracles and marvels; predictability and uniformity; statistical and numerical laws; and necessity-in-praxis.
Table des matières
Preface
Part I. Theory
1. 'Near'
laws and 'real' laws
2. Falling
under a physical law
3. 3
theories of physical laws
4. Modal
properties and modal propositions; relative and absolute necessity
5.
Regularity attacked / Necessitarianism defended
6. Failure
versus doom
7.
State-descriptions and reductions
8.
Potentialities
Part II. Applications
9. Miracles
and marvels
10. Free
will and determinism
11.
Predictability and uniformity
Part III. The theory extended
12.
Statistical laws
13.
Counterfactuals, numerical laws, and necessity in praxis
Postscript : cosmic coincidence
Un extrait
In the scientific journals, the degree of sophistication increases and the vocabulary broadens, but the essential point remains the same: The scientific laws derived are not 'deduced' from fundamental theories, but are arrived at through layers of simplifying assumptions and approximations.
L'auteur : Norman Swartz est Professeur émérite à Burnaby, en Colombie Britannique, Canada.
Se procurer ce livre : Téléchargeable intégralement et gratuitement sur le site de l'auteur : [SWARTZ - Concept of Physical Law]. Les Canadiens sont des gens bien, ça se confirme. Pour le remercier : swartz@sfu.ca.
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Un livre facilement accessible en traduction française, par l'un des maîtres de la physique quantique qui a une réflexion personnelle originale sur la nature de l'opération de modélisation du réel. Sa théorie de ce qui est simple et de ce qui ne l'est pas, ainsi que sa théorie des "niveaux de grain" d'une théorie (comme une photo) sont abordables et éclairantes.
4e de couverture : Qu'est-ce qui relie la physique des particules la plus abstraite aux objets de notre vie quotidienne ? Comment penser à la fois, et selon quelle dialectique, les constituants les plus simples de la matière, l'histoire de l'évolution, les organismes vivants les plus sophistiqués, et toute la complexité biologique et culturelle de l'homme - jusqu'à ses langues et ses formes de société ? Apparemment, il n'existe pas de lien entre les uns et les autres. Pourtant, Murray Gell-Mann, prix Nobel 1969 pour la théorie des quarks dont il a été l'inventeur, montre comment, de la bactérie qui développe une résistance aux antibiotiques jusqu'à l'enfant qui apprend à parier, de la formation des galaxies à celle des différentes cultures, de la pensée créatrice à la simulation informatique, se déploie l'interrelation de la simplicité la plus nue et de la complexité extrême. Professeur émérite au Californian Institute of Technology (le Caltech) et fondateur du Santa Fe Institute, partisan d'un équilibre harmonieux entre progrès technologique et protection de l'environnement, Murray Gell-Mann souligne l'extraordinaire richesse de cette nouvelle approche ou se rencontrent les avancées les plus spectaculaires de la pbysique quantique, de celle des particules, de la cosmologie, de la théorie de l'évolution, de la biologie et de la génétique, et des nouveaux outils informatiques.
Table des matières
I. Le simple et le complexe
II. L'univers quantique
III. Sélection et adaptation
IV. Diversité et durabilité
Index
L'auteur : Physicien américain né en 1929, Prix Nobel en 1969, il a enseigné au California Institute of Technology de 1955 à 1994.
Se procurer ce livre :
disponible
en poche [site
amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Un philosophe darwinien décapant, qui propose de tout recommencer à zéro, y compris la théorie de la conscience, de la connaissance, de la science.
Table des matières
Preface
Part I: Starting in the Middle
CHAPTER ONE Tell Me Why
1. Is
Nothing Sacred?
2. What,
Where, When, Why -- and How?
3. Locke's
"Proof" of the Primacy of Mind
4. Hume's
Close Encounter
CHAPTER TWO An Idea Is Born
1. What Is
So Special About Species?
2. Natural
Selection -- an Awful Stretcher
3. Did
Darwin Explain the Origin of Species?
4. Natural
Selection as an Algorithmic Process
5.
Processes as Algorithms
CHAPTER THREE Universal Acid
1. Early
Reactions
2. Darwin's
Assault on the Cosmic Pyramid
3. The
Principle of the Accumulation of Design
4. The
Tools for R and D: Skyhooks or Cranes?
5. Who's
Afraid of Reductionism?
CHAPTER FOUR The Tree of Life
1. How
Should We Visualize the Tree of Life?
2.
Color-coding a Species on the Tree
3.
Retrospective Coronations: Mitochondrial Eve and Invisible Beginnings
4.
Patterns, Oversimplification, and Explanation
CHAPTER FIVE The Possible and the Actual
1. Grades
of Possibility?
2. The
Library of Mendel
3. The
Complex Relation Between Genome and Organism
4.
Possibility Naturalized
CHAPTER SIX Threads of Actuality in Design Space
1. Drifting
and Lifting Through Design Space
2. Forced
Moves in the Game of Design
3. The
Unity of Design Space
Part II: Darwinian Thinking in Biology
CHAPTER SEVEN Priming Darwin' s Pump
1. Back
Beyond Darwin's Frontier
2.
Molecular Evolution
3. The Laws
of the Game of Life
4. Eternal
Recurrence -- Life Without Foundations?
CHAPTER EIGHT Biology Is Engineering
1. The
Sciences of the Artificial
2. Darwin
Is Dead -- Long Live Darwin!
3. Function
and Specification
4. Original
Sin and the Birth of Meaning
5. The
Computer That Learned to Play Checkers
6. Artifact
Hermeneutics, or Reverse Engineering
7. Stuart
Kauffman as Meta-Engineer
CHAPTER NINE Searching for Quality
1. The
Power of Adaptationist Thinking
2. The
Leibnizian Paradigm
3. Playing
with Constraints
CHAPTER TEN Bully for Brontosaurus
1. The Boy
Who Cried Wolf?
2. The
Spandrel's Thumb
3.
Punctuated Equilibrium: A Hopeful Monster
4. Tinker
to Evers to Chance: The Burgess Shale Double-Play Mystery
CHAPTER ELEVEN Controversies Contained
1. A Clutch
of Harmless Heresies
2. Three
Losers: Teilhard, Lamarck, and Directed Mutation
3. Cui
Bono?
Part III: Mind, Meaning, Mathematics, and Morality
CHAPTER TWELVE The Cranes of Culture
1. The
Monkey's Uncle Meets the Meme
2. Invasion
of the Body-Snatchers
3. Could
There Be a Science of Memetics?
4. The
Philosophical Importance of Memes
CHAPTER THIRTEEN Losing Out Minds to Darwin
1. The Role
of Language in Intelligence
2. Chomsky
Contra Darwin: Four Episodes
3. Nice
Tries
CHAPTER FOURTEEN The Evolution of Meanings
1. The
Quest for Real Meaning
2. Two
Black Boxes
3. Blocking
the Exits
4. Safe
Passage to the Future
CHAPTER FIFTEEN The Emperor's New Mind, and Other Fables
1. The
Sword in the Stone
2. The
Library of Toshiba
3. The
Phantom Quantum-Gravity Computer: Lessons from Lapland
CHAPTER SIXTEEN On the Origin of Morality
1. E
Pluribus Unum?
2.
Friedrich Nietzsche's Just So Stories
3. Some
Varieties of Greedy Ethical Reductionism
4.
Sociobiology: Good and Bad, Good and Evil
CHAPTER SEVENTEEN Redesigning Morality
1. Can
Ethics Be Naturalized?
2. Judging
the Competition
3. The
Moral First Aid Manual
CHAPTER EIGHTEEN The Future of an Idea
1. In
Praise of Biodiversity
2.
Universal Acid: Handle with Care
Appendix
Bibliography
Index
Un extrait
The "miracles" of life and consciousness turn out to be even better than we imagined back when we were sure they were inexplicable.
L'auteur : Philosophe américain né en 1942. Il travaille en philosophie des sciences, de la biologie et en sciences cognitives. Ses livres sont des best-sellers et représentent un courant de pensée athée, très minoritaire aux USA.
Se procurer ce livre : La
traduction française est
trouvable en bibliothèque mais indisponible à la
vente...
as usual. L'original anglais est disponible en poche, as usual : [site
amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Mode d'emploi : Une fois acquises les bases de l'épistémologie critique, il est utile de découvrir dans ce livre qu'une vision de la science tout à fait classique peut leur survivre, leur résister, et bien plus qu'honorablement. Ce livre est vraiment philosophique : on y perd quelques-unes de ses convictions les moins bien assurées, donc on progresse.
4e de couverture :
Since the 1950s, many philosophers of science have attacked positivism — the theory that scientific knowledge is grounded in objective reality. Reconstructing the history of these critiques, John H. Zammito argues that while so-called postpositivist theories of science are very often invoked, they actually provide little support for fashionable postmodern approaches to science studies.
Zammito shows how problems that Quine and Kuhn saw in the philosophy of the natural sciences inspired a turn to the philosophy of language for resolution. This linguistic turn led to claims that science needs to be situated in both historical and social contexts, but the claims of recent "science studies" only deepened the philosophical quandary. In essence, Zammito argues that none of the problems with positivism provides the slightest justification for denigrating empirical inquiry and scientific practice, delivering quite a blow to the "discipline" postmodern science studies.
Filling a gap in scholarship to date, A Nice Derangement of Epistemes will appeal to historians, philosophers, philosophers of science, and the broader scientific community.
Table des matières
Introduction
1.From positivism to post-positivism
2.The perils of semantic ascent: Quine and post-positivism in the Ph o Sci
3.Living in different worlds? Kuhn's misadventures with incommensurability
4.Doing Kuhn one better? The (failed) marriage of history and philosophy of science
5.How Kuhn became a sociologist (and why he didt'n lik it). The Strong Program and the social reconstruction of science
6.All the way down: social constructivism and the turn to microsociological studies
7.Women, ANTs, and (other) dangerous things: “hybrid” discourses
8.A nice derangement of epistemes: radical reflexivity and the science wars
Conclusion: The hyperbolic derangement of epistemes
Se procurer ce livre : [sur site amazon].
[< retour début de liste année 4] [<<< retour liste années]
Sélection des livres téléchargeables dans cette bibliographie
[POINCARE - La valeur de la science][DUHEM- Théorie physique]
[BERNARD - Introd. à l'étude de la médecine expérimentale]
[SWARTZ - Concept of Physical Law]
Participez à cette page ! Notamment en signalant publications en ligne et réimpressions, ou en suggérant des améliorations à l'utilité de ce type de page. [rappel mail MP]